| |
Manifeste de pacotille |
| |
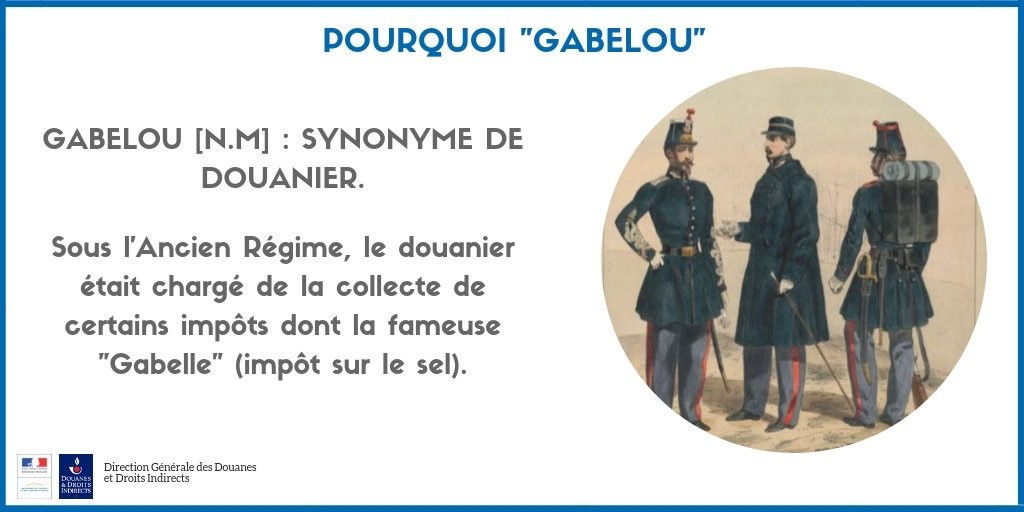 |
|
Dans le théâtre des hommes il y a des histoires de gabelous,
vous savez, sous l’ancien Régime, ces agents chargés de collecter l'impôt sur
le sel, la « gabelle»…
…On les appelle aujourd’hui les douaniers.
|
C’était au temps des frontières, bien réelles, identitaires
et évidemment économiques (il en reste, mais on ne s’en rend plus compte tant
le passage des frontières est maintenant presque fictif dans l’espace européen)
On n’importait pas quoi que ce soit sans acquitter les droits
de douane.
Il
s’est toujours trouvé des individus pour braver les règles, parfois au prix de
sérieux risques. |
|
Dans mon Jura natal, sur les hauteurs des bassins du Doubs, la
contrebande allait bon train entre la France et la Suisse voisine. Il en reste un
chemin des contrebandiers, lesquels empruntaient alors des échelles pour
escalader les falaises et contourner ou semer les douaniers.
Aujourd’hui, ces faits alimentent le patrimoine historique
et… Touristique : il est permis d’entreprendre, à titre d’escapade en
randonnées, au‑dessus des bassins du Doubs,
les « échelles de la
mort ».
|
|
 |
Ces chemins de contrebande, on en a trace sur toutes les
anciennes frontières, dans les Pyrénées, dans les Alpes etc…
Les navigants ont évidemment franchi de nombreuses frontières
au cours de leur vie professionnelle.
Avant l’époque moderne du transport aérien, les marins
embarquaient leur pacotille, petite quantité de marchandises que les officiers,
matelots ou passagers d'un navire avaient le droit d'emporter avec eux pour en
faire commerce. C’était leur tolérance douanière.
Dans une époque plus récente, ces tolérances douanières
n’étaient pas les mêmes pour tous les citoyens français. Ainsi les citoyens
frontaliers faisaient l’objet d’un contrôle plus sévère, d’une moindre
tolérance de la part des douanes.
Les navigants de l’aviation civile étaient et, aujourd’hui
encore je crois, sont considérés comme des frontaliers. La tolérance douanière,
valeur au-dessus de laquelle on doit acquitter des droits, était, selon un
ancien navigant, vers 1970, de 15 francs, soit à peu près 16,5 Euros…
J’avoue ne pas m’en souvenir.
Lors d’un retour en France, le passage de la frontière,
pour les équipages du transport aérien, se faisait en présentant à la douane
une déclaration écrite :
|
Le manifeste
de pacotille |
|
| |
|
| |
Ces passages en douane étaient assez redoutés, car à
l’époque où les produits manufacturés du Japon ou des USA étaient notoirement
moins chers en ce début de civilisation de consommation, dans les années soixante‑dix,
les navigants revenaient avec nombre de ces produits pour eux, pour leur
famille, leurs amis, voire chez certains navigants, pour en faire un petit
commerce… Télévision « trinitron », premiers « walkman » en
provenance du Japon, lunettes « Rayban », répondeur, fax, valises
« samsonite » (frottées au savon pour les faire vieillir !) au
retour de New‑York, fauteuils « Emmanuelle » provenant de
Bangkok, poteries éléphants porte-pots de fleurs de Saïgon… etc.
On rapportait aussi un artisanat typique de certaines
destinations : miroirs d’Amérique latine, tapisseries « Youri »
de Lima, jeux d’échecs du Mexique, ou des plantes comme les Yukas du Brésil…
La déclaration/rédaction, écrite et paraphée, sur le
manifeste de pacotille, était cruciale. La tricherie, s’il est humain de la
pratiquer, était, il faut le dire, généralisée, mais il fallait garder une
juste mesure !
Le système douanier est un système dans lequel la délation
est organisée, un ami directeur des douanes me l’avait confirmé : Il y
avait des indicateurs en douane chez les navigants. Il s’agissait en général d’êtres
faibles qui s’étaient faits prendre, et auxquels on avait proposé ce marché de
délateurs. Ils étaient sans doute moins nombreux que l’on ne l’imaginait, mais
certains individus alimentaient la suspicion, et il fut même un temps où
circulaient des listes de donneurs en douane (ambiance garantie pour les
individus listés, parfois sur l’effet d’un simple règlement de comptes
personnel, et qui se retrouvaient dans un équipage au su de ces listes). On
n’est pas dans le meilleur des mondes, dans quelque milieu professionnel que ce
soit, si ce n’est au sens qu’Aldous Huxley a voulu donner à cette
périphrase…
Et les témoignages de navigants retraités refont
aujourd’hui surface pour évoquer ces rédactions farfelues et empreintes d’une
imagination sans bornes, faites pour trouver la formulation pas totalement
fausse mais toujours totalement tricheuse… C’était dissimuler avec le secret
espoir de s’en sortir si d’aventure le douanier avait le sens de l’humour… Ce
qui n’avait aucune chance d’être. Ça passait ou ça cassait !
Souvent les navigants
entraient en conciliabule pour déclarer de manière cohérente les uns avec les
autres :
-
Tu déclares ça combien ?
-
T'es fou, c'est trop (ou pas assez
)
… Et voici un petit florilège de ces déclarations:
«chaussures pour mon
fils » (pointure 46)
« poissons rouges »... pour des saumons d’Alaska
« épicerie »... pour du caviar de Moscou
« quincaillerie » ... pour une tondeuse à gazon motorisée
Les douaniers évidemment n’étaient pas dupes, et ils
exerçaient un double contrôle : D’une part une appréciation de la valeur
déclarée des produits, laquelle faisait parfois l’objet d’un redressement,
d’autre part une fouille aléatoire ou systématique des bagages… Et la procédure,
de toute façon, se poursuivait par une taxation écrite qu’il fallait acquitter
sur le champ.
Une hôtesse récemment disparue, Nicole L., avait trouvé une
formulation passe‑partout : "babioles et colifichets ".
Celle-ci permettait de rester dans le vague et de ne s’exposer, le cas échéant,
qu’à un redressement raisonnable lorsque le douanier considérait que le
colifichet était plus colis que fichet... !
A Orly, au retour d’un long courrier, il y avait un
douanier spécialiste de la fouille des bagages des jeunes hôtesses (à cette
époque, il n’y avait qu’une seule femme pilote à la compagnie, et je doute
qu’elle eut mis les sens du douanier en éveil…). Il prenait un malin plaisir, presque
rougissant, à retourner les petites culottes et autres sous‑vêtements,
avec une constance maniaque… On l’appelait le boutonneux car il n’était pas
encore sorti de sa période d’acné juvénile, bien qu’approchant probablement la
trentaine !
Autant dire que lors des « pots équipage »,
tradition bien ancrée, qui réunissait l’équipage en escale pour un apéro, au
cours duquel on se racontait ses excursions et ses aventures personnelles ou
professionnelles, le boutonneux était habillé pour les quatre saisons !
Ce
récit doit beaucoup aux navigants retraités qui ont bien voulu faire appel à leurs
souvenirs. Il y a quelques anecdotes cocasses sur ces passages en douane. Ainsi
ce navigant qui rapporte de Dallas des filtres pour des avions T6 (vieux
« war bird ») et qui déclare des filtres pour la hotte aspirante de
sa cuisine… Aussi cette hôtesse qui raconte que, sur son premier vol, donc très
jeune hôtesse, son « parrain » professionnel l’avait chargée de
présenter le manifeste de pacotille, vocable qui lui était peu familier, et qui
avise alors les douaniers en leur disant ceci : « Bonjour messieurs,
c’est moi qui suis chargée de la bagatelle ». Succès garanti !
Ce document comme beaucoup de choses faisait l’objet d’une
contrepèterie :
« manitille
de pacofesse » !
Furent aussi rapportés
quelques objets insolites, comme ce cheval de manège, en bois, qui ne rentrait
évidemment pas dans quelque bagage équipage que ce soit, et dont la valeur
marchande était des plus incertaines.
Au retour « d’un
Bangkok » une hôtesse avait dissimulé un Bouddha de jade de
vingt centimètres dans un sac de cinq kilos de riz basmati, sans en parler au reste
de l’équipage. Le douanier a posé lourdement le sac sur le comptoir et la toile
a craqué, déversant le riz et révélant le Bouddha! Et hop, tout l’équipage
fouillé !!! |
Après la fusion en 1992 entre
les compagnies Air‑France, |
 |
et UTA, |
 |
les
navigants d’Air France ont redécouvert le « secteur Afrique ». |
En effet, il fut un temps où Air France desservait
l’Afrique noire, des équipages étant alors basés à Dakar. Et puis, les affaires
étant les affaires, le groupe chargeurs réunis, propriétaire de la compagnie
UTA, après la création en 1963 de cette compagnie par fusion entre la TAI (Transport
Aériens Intercontinentaux, qui opérait principalement vers l’Asie) et l’UAT
(Union Aéromaritime de Transport, qui opérait vers l’Afrique), avait obtenu du
gouvernement l’exclusivité des droits d’exploitation de ce secteur Afrique,
lequel générait des recettes juteuses.
Ainsi lorsque je me trouvai qualifié sur Airbus A310, après
vingt ans de carrière, c'est alors seulement que je découvris les escales Africaines telles
qu’Abidjan, Ouagadougou, Bamako, Bangui, Njamena, Lome, Cotonou Nouakchott etc.
Dans
la nuit du 1er août 1993 je suis arrivé à Bangui pour la
première fois… J’ai aperçu, lors du transport depuis l’aéroport vers l’hôtel,
ce qu’il était resté de décennies de corruption postcoloniale avec l’épisode
tragi-comique de l’empire Bokassa : maisons délabrées, errances
d’individus et de chiens dans des rues non pavées aux couleurs de latérite.
| Bangui, sa latérite et le fleuve Oubangui... |
|
 |
Au
réveil, j’ai tiré le rideau de ma chambre et suis tombé en état de
contemplation pour ce qui se présentait devant moi : La majesté, le calme
et la volupté du fleuve Oubangui, sur lequel des pêcheurs en pirogue
lançaient leurs éperviers d’un geste presque hiératique…
L’éternité de
l’Afrique, celle que j’avais pressentie à travers mes cours de géographie à
l’école primaire, où il était encore question d’Afrique équatoriale française
(AEF).
Après le petit-déjeuner me voici déambulant et relaxant
dans les jardins de l’hôtel. Je rencontre un premier centre-africain, fort
poli, me voussoyant, et me proposant de magnifiques papillons. Il m’explique
qu’il a été éduqué par les pères blancs, en religion mais aussi en instruction
générale, de même qu’à la chasse aux papillons… |
|
 |
Je n’ai pas mis longtemps à
faire affaire avec ce personnage presqu’anachronique, déjà à l’époque… Mais je
ne sais plus dire ce que sont devenus ces papillons, plus d’un quart de siècle
plus tard, et après trois déménagements… Probablement un tas de poussières… Et
alors que je m’apprêtais à sortir dans les rues de Bangui, je rencontre un
autre individu, plus du tout anachronique, et tout aussi sympathique (c’était
encore un temps où un « vieux blanc » n’était pas vu, voire agressé,
comme un ancien colon criminel de je ne sais quoi…).
La conversation donne à peu près ceci :
Lui :- Tu connais le
commandant L. » ?
Moi : « Je ne
connais que lui, c’est un ami »
Lui : « J’ai toujours
sa pirogue »
Moi : « Qu’est-ce
que tu me dis ??? »
Lui : « Oui, il m’a
acheté une pirogue mais il n’est toujours pas venu la chercher »
Moi : « Tu peux
me la faire voir ? »
Lui : « Elle est
dehors dans le jardin de l’hôtel »
… Et nous voilà partis à la rencontre de la pirogue, et
pour ce qui me concerne avec la certitude jubilatoire de connaître un épisode
que l’on ne peut vivre qu’en Afrique.
 |
|
Les pirogues de
l’Oubangui, mues par les pêcheurs à l’aide de grandes perches, sont taillées
dans un tronc d’arbre juste ébranché. S’agissant d’arbre d’essence « fromager »,
le bois, léger et tendre, permet la réalisation rapide et facile d’une pirogue
en taillant dans la masse du tronc…
Problème : Le fromager est un bois légèrement poreux
et qui vieillit mal, et on le met au rebus quand il a fait son temps…
|
La pirogue ne vaut alors plus rien, elle a
perdu sa flottaison et ne permet plus d’aller à la pêche sur le fleuve, dans
lequel on soupçonne la présence de ces variétés de poisson : Les M’boutou
(poisson à la chair très fine), les Kpété (poisson d'eau douce très
apprécié en grillade en Centrafrique, les Cougou (variété de poisson abondante
en RCA et les Capitaines (poissons à nageoires rayonnées). Les pêcheurs
utilisent des filets (éperviers), « celui de deux doigts et celui de cinq
doigts »
|
|
 |
Mon ami le commandant L., se voyant proposé d’acheter une
pirogue s’en trouva fort amusé. Il n’était pourtant pas de la dernière pluie et
il proposa un prix qu’il considérait comme extrêmement bas et à l’évidence irrecevable…
Sauf que sa première offre fut immédiatement acceptée et il n’eut d’autre
choix, sauf le déshonneur, que de payer et se retrouver propriétaire d’une
magnifique pirogue … Définitivement réformée (ce qu’il ignorait alors !).
Il entama des négociations avec un chauffeur de taxi pour
convoyer sa pirogue vers l’aéroport à l’heure du vol dont il assumait la
responsabilité… mais l’Afrique postcoloniale étant ce qu’elle est, des troubles
séditieux commencèrent à Bangui, le couvre-feu fut décrété (et assuré par
l’armée française dans le cadre d’un accord militaire), de sorte qu’il ne fut
pas possible à mon ami de rapporter sa pirogue… Fin de l’acte un de cette
gentille opérette.
Me voici donc acteur de l’acte deux (nous sommes loin de
l’unité de temps du théâtre classique !) et me trouvant devoir revenir
avec un autre vol sur Bangui, seulement une dizaine de jours plus tard, je
propose à mon interlocuteur centrafricain un nouveau rendez-vous à cette future
occasion. De fait, je voulais quand même une discussion avec mon ami pour mieux
cerner la situation ! Il me confirmera les faits et je lui proposai de
tout faire pour rapporter sa belle pirogue.
Me voici de nouveau à Bangui en ce début d’août 1993, et je
ne tarde pas à tout arranger pour rapporter cette magnifique embarcation de
l’Oubangui… Accord passé avec un chauffeur de taxi équipé de barres de toit,
heure du rendez-vous fixée (un peu avant l’heure du ramassage de l’équipage).
Notre retour devant se faire en vol de jour, tout paraissait simple… C’était
sans compter avec les aléas de l’Afrique : Il s’est avéré que des troubles
sérieux ayant commencé à Ndjamena, notre escale sur le retour vers Paris, la
compagnie a reprogrammé le vol pour un retour de nuit après que l’armée
française eut sécurisé l’aéroport… Nous voici donc ramassés à l’hôtel, fort
tardivement, vers le milieu de la nuit, et de chauffeur de taxi pour ma
pirogue… Point… Mais l’équipage tout aussi amusé que moi, me propose alors de
charger la pirogue dans un des deux minibus prévus pour l’équipage… Aussitôt
fait, la pirogue et les bagages équipage dans l’un, l’équipage entassé dans
l’autre, et nous voici traversant un Bangui à peine éclairé, à suivre en
cahotant sur la latérite notre pirogue qui dépassait d’au moins trois mètres à
l’arrière du minibus (nous l’avions installée dans le couloir, porte arrière
laissée ouverte) !
Arrivés à l’aéroport, je règle un premier problème :
Faire charger la pirogue dans la soute en vrac de l’Airbus A310. Le chef bagagiste,
un colosse sympathique, rentre dans mon jeu et m’assure s’en occuper.
Après les tâches habituelles de préparation du vol, nous
nous retrouvons au cockpit à préparer le décollage, et, avant la mise en route
des moteurs, le colosse bagagiste vient m’informer du succès de l’opération
pirogue (je n’oublierai jamais son air réjoui !) :
« Commandant, ta planche à voile, elle est
chargée ! » … Avec le pittoresque de l’accent, bien entendu.
L’officier pilote, Philippe N. (1), l’officier mécanicien
navigant, et, pour tout dire, l’ensemble de l’équipage adhèrent à la bonne
ambiance que ces tribulations africaines nous procurent.
Et le vol de nuit nous mobilisa.
Après le décollage de Ndjamena, j’entrepris de contacter
mon ami Yves (le commandant L.), par liaison HF avec la station de Stockholm radio,
laquelle nous mit en relation téléphonique. Nous convînmes alors de nous retrouver
en piste après l’atterrissage à Paris.
Au débarquement de l’équipage, à l’aéroport
Charles De Gaulle, la procédure consistait à récupérer nos bagages
équipages au pied de l’avion, et d’embarquer dans la navette qui nous était
prévue pour rejoindre les bâtiments d’Air France. Mais quid de la
pirogue ? J’avais bien entendu la complicité des bagagistes pour me la
mettre au pied de l’avion, mais elle ne rentrait pas dans la navette ! Le
chauffeur de celle-ci, un pied noir, s’associa avec hilarité et jubilation à
notre aventure, et me pria d’attendre en promettant de revenir avec un autre
véhicule plus adapté. Mon ami Yves nous avait rejoint en piste, et c’est ainsi
que nous arrivâmes devant les bâtiments de la compagnie avec notre embarcation
totalement incongrue, et aux yeux ébahis de tous les navigants présents.
J’avais pris soin de garder un exemplaire du manifeste de
pacotille, sur lequel j’avais dûment déclaré « une pirogue de
l’Oubangui ».
Mon grand regret est de n’avoir pu observer la tête des
douaniers à prendre connaissance du manifeste, car leur bureau était fermé et
nous nous sommes contentés de glisser ce manifeste subrepticement sous la
porte.
C’était le 10 août 1993.
L’avion a terminé son exploitation chez
Kibris Turkish Airlines, il est aujourd’hui retiré et rayé des
registres.
La pirogue repose en paix dans la maison de campagne de mon
ami, dans l’Oise.
La pacotille n’est plus ce qu’elle était.
La Clusaz, Août 2019
© Jean Louis Chatelain
|
|
 |
1) Philippe était un personnage un peu mystérieux, en tout cas atypique. Il était comme étranger à sa propre vie, et à son travail. Quelques sept années plus tard, ils seront, lui et son épouse, torturés dans leur maison, et sauvagement assassinés par leur propre fils adoptif. |
|
